
La Mise en abyme imagée
- Jean-Marc Limoges
_______________________________
La mise en abyme (l’œuvre dans l’œuvre) est une configuration dont tous les arts – littérature, théâtre, peinture, photographie, cinéma, musique, bande dessinée – nous auront fait entrevoir les multiples visages. Cependant, comme la mise en abyme ne se résume pas au simple « roman dans le roman », « tableau dans le tableau » ou « film dans le film » mais qu’elle peut aussi nous offrir divers métissages – bande dessinée dans le film, pièce de théâtre dans le roman, tableau dans la photo –, cette configuration peut vite gagner en complexité. Nous voudrions ici comparer la mise en abyme littéraire et la mise en abyme cinématographique, et plus particulièrement la mise en abyme cinématographique imagée (que l’on pourrait distinguer des mises en abyme sonores – voire bruitées, parlées ou musicales – et écrites) ; film dans le film certes, mais aussi émission de télévision dans le film, tableau dans le film, photo dans le film, etc. Plus précisément encore, c’est aux rapports temporels entre l’image dans le film et le film lui-même que nous voudrions réfléchir afin d’établir ceux qui seraient propres à la mise en abyme cinématographique imagée (et que les mises en abyme littéraires – ou que les mises en abyme cinématographiques sonores ou écrites – ne sauraient nous offrir, sinon au prix de diverses contorsions). Nous proposerons, à partir des incontournables travaux de Lucien Dällenbach sur la mise en abyme en littérature, de la brillante suite que lui a donnée Dominique Blüher au cinéma et d’une précision sur laquelle Sébastien Févry a attiré notre attention, cinq rapports temporels possibles, dont le dernier seulement – celui que nous ajouterons à la liste – sera propre à la mise en abyme cinématographique imagée.
Types de mises en abyme
Dans Le Récit spéculaire : essai sur la mise en abyme, Lucien Dällenbach, passant en revue les ouvrages ayant porté sur la mise en abyme depuis le fameux Journal (1889-1939) d’André Gide, remarque d’abord que plusieurs « auteurs confond[ent] sous un terme unique [« mise en abyme »] des réalités distinctes » (p. 59). Il soutient, au terme de ce survol, que la mise en abyme peut les incarner toutes les trois « sans jamais cesser de rester une » (p. 52). Il en propose alors trois « types » [1] : la mise en abyme est « simple » quand le « fragment [emboîté] entretient avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude » (p. 51), elle est « infinie » quand le « fragment [emboîté] entretient avec l’œuvre qui l’inclut un rapport de similitude et (…) enchâsse lui-même un fragment qui…, et ainsi de suite » (p. 51) et elle est « aporistique » – ou peut-être faudrait-il dire « aporétique » – quand le « fragment [emboîté est] censé inclure l’œuvre qui l’inclut » (p. 51). Ces précisions permettent ainsi à l’auteur de reformuler la définition de la mise en abyme qu’il avait donnée (définition que nous reformulons à notre tour pour des besoins de clarté tout en respectant la pensée de l’auteur) : « est mise en abyme tout miroir interne [ou toute œuvre emboîtée] réfléchissant [un aspect] du récit [ou de l’œuvre emboîtante] par réduplication simple, [infinie] ou [aporétique] » (p. 52). Nous reproduisons le tableau suivant (dont les icônes sont de nous) :
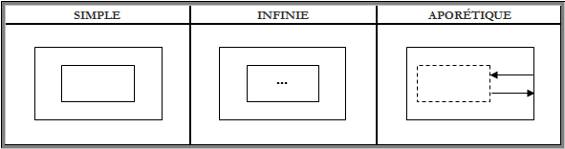
Pour
illustrer ce qu’il entend par mise en abyme simple,
Dällenbach donne plusieurs exemples tirés notamment
du roman français du XIXe siècle. Il cite La
Muse du département de Balzac, où nous
pouvons lire les fragments d’un autre roman, Olympia
ou les Vengeances romaines,
réfléchissant une partie de l’histoire
; L’Homme qui rit de Hugo,
où nous trouvons le résumé
d’une représentation écrite par Ursus, Chaos
vaincu, mettant en scène, de façon
métaphorique, le propos même du récit ;
La Curée de Zola, où on
présente d’abord la Phèdre
de Racine, mais aussi le poème dramatique de M. Hupel de la
Noue, Les Amours du beau Narcisse et de la Nymphe
Écho, pièce dans laquelle la relation
unissant les protagonistes renvoie à celle
qu’entretiennent Renée et Maxime ; La
Légende de saint Julien l’Hospitalier
de Flaubert, où nous pouvons entendre une
prophétie préfigurant le destin du
héros, Julien ; et Une vie de
Maupassant, où le narrateur décrit une tapisserie
représentant les malheurs de Pyrame et de Thisbé
annonçant également le destin de
l’héroïne, Jeanne. Dans tous ces cas, une
œuvre (roman, pièce, poème,
prophétie, tapisserie) [2]
réfléchit
un moment de l’histoire (passé, présent
ou à venir) du roman dans lequel elle se trouve.
Pour
illustrer ce qu’il entend par mise en abyme infinie,
Dällenbach évoque Paludes
d’André Gide, qui met en scène un
romancier écrivant Paludes (pp. 42-45
et aussi p. 146, n. 2) et Contrepoint
d’Aldous Huxley, contenant des « extraits
du carnet de Philip Quarles », également
romancier, rêvant d’« introduire
dans le roman un romancier », puis
« un second, dans le roman du
premier », puis « un
troisième, dans le roman du second » et
« ainsi de suite, jusqu’à
l’infini » (pp. 32-40 et aussi p. 146, n.
1). Il faut toutefois admettre qu’il n’y a pas,
à proprement parler, dans les romans de Gide ni de Huxley,
de roman reprenant le roman reprenant le roman… Dans un cas,
le roman Paludes qu’écrit le
narrateur de Paludes n’est pas
l’histoire de quelqu’un écrivant Paludes
(mais bien l’histoire de Tityre), dans l’autre, il
n’y a même pas de roman, mais simplement
l’« idée »
d’un roman.
Mais
Dällenbach mentionne aussi Les mille et une nuits,
fresque dans laquelle évolue un personnage –
Schéhérazade – devant passer le reste
de ses jours à raconter des histoires au Sultan, et dont
l’une – du moins dans la
« version » de Borges –
constitue l’histoire d’un personnage racontant des
histoires au Sultan (p. 145, n. 1). Tzvetan Todorov rappelle le
passage, tiré des Enquêtes
de Borges :
Aucune [interpolation] n’est plus troublante que celle de la six cent deuxième nuit, magique entre les nuits. Cette nuit-là, le roi entend de la bouche de la reine sa propre histoire. Il entend l’histoire initiale, qui embrasse toutes les autres, qui – monstrueusement – s’embrasse elle-même… Que la reine continue et le roi immobile entendra pour toujours l’histoire tronquée des Mille et une nuits, désormais infinie et circulaire… [3]
Bien que cette lecture soit des plus convaincantes, il faut toutefois souligner que Dällenbach est revenu sur ce passage en ces termes : « La vertu auto-enchâssante (d’ailleurs partielle, contrairement à ce qu’affirme Borges dans Enquêtes) de cette six cent deuxième nuit est sans doute imputable à la manière dont les contes ont été réunis en recueil. Felix culpa ! » (p. 121, n. 1). Réservons quand même l’exemple, et admettons que Schéhérazade raconte bel et bien au Sultan l’histoire de Schéhérazade racontant des histoires au Sultan…
[1]
Nous ne parlerons pas, ici, des
« espèces »
– ou des « mises en abyme
élémentaires » (les mises en
abyme « fictionnelle »,
« énonciative »,
« textuelle »,
« métatextuelle » et
« transcendantale ») –
que recense aussi Dällenbach, afin de ne pas alourdir
inutilement notre propos. Il n’est qu’utile de
savoir que toutes les mises en abyme dont nous parlerons seront des
mises en abyme « de
l’énoncé » ou plus
précisément des « mises en
abyme fictionnelles ».
[2]
On aura compris que l’œuvre dans
l’œuvre peut revêtir diverses formes. Ce
qui, dans l’œuvre, réfléchit
(ou cite ou résume) la fiction elle-même peut
être, égrène Dällenbach, une
« lettre » (p. 77, n. 3), un
« manuscrit » (p. 92), un
« livre » (p. 92), un
« roman » (p. 86), une
« nouvelle » (p. 77, n.1 et p.
96), un « conte » (pp. 80-81 et
p. 97), une
« légende » (p. 97),
un « mythe » (pp. 80-81), un
« refrain » (p. 94, n. 3), une
« chanson » (p. 84), un
« oratorio » (p. 88), une
« représentation
théâtrale » (p. 77, n. 3, p.
94, n. 2 et pp. 97-98), voire une
« prophétie » (p. 84)
ou un « présage » (p.
84) ou encore une « tapisserie »
(p. 86) ou un « tableau » (p. 88
et p. 94, n. 3), bref, une « œuvre
d’art » (p. 95), que celle-ci soit
« peinture, pièce de
théâtre, morceau de musique, roman, conte,
nouvelle » (p. 95).
[3] T.
Todorov, Poétique de la prose,
Paris, Seuil,
« Poétique », 1971, p.
84.


