
Michel Butor, le poète illustrateur
- Márcia Arbex-Enrico
_______________________________
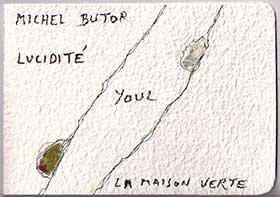
Fig. 9. M. Butor et Youl, « Lucidité », 2015 
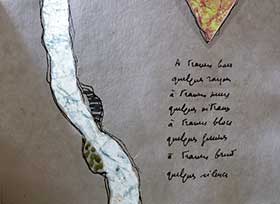
Fig. 10. M. Butor et Youl, « Lucidité », 2015 
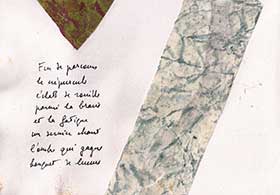
Le lecteur est sollicité par les yeux mais aussi par le toucher : le geste de feuilleter peut se substituer à celui de détacher, défaire un nœud, démonter, remonter, réattacher. Le livre se défait parfois entre nos mains. A la place d’une superficie blanche, lisse et sans ratures, la trame du papier, la texture plus ou moins rugueuse, l’épaisseur obtenue par les couches de matières superposées appellent au toucher. Dans Lucidité (2015) (figs. 9, 10 et 11), petit livre fabriqué par Youl dans du papier artisanal, composé d’un cahier de quatre pages détachées, dont le format rectangulaire se distingue de ceux cités plus haut, certaines pages ont été découpées comme pour créer des fissures et, ensuite, elles ont été recouvertes par d’autres papiers colorés, mais translucides. Si, à première vue, l’émouvant poème sur le « lucide crépuscule » de la vie ne présente pas de lien avec l’objet-livre, il suffit de le déplacer à la verticale pour que se produisent les « contaminations transgressives ».
Lucidité
Que de fouillis
dans ma mémoire
que de brouillard
dans mes idées
que de chaos
dans mes journées
que de désordre
dans mon bureau
J’entendais mieux
je voyais mieux
je tapais mieux
sur la machine
je marchais mieux
sur les sentiers
je voyageais
plus aisément
A travers bois
quelques rayons
à travers murs
quelques vitraux
à travers blocs
quelques fissures
à travers bruit
quelques silences
Fin de parcours
le crépuscule
éclats de rouille
parmi la fatigue
un dernier chant
l’ombre qui gagne
bouquet de lueurs.
Le lecteur est surpris par la transparence du papier laissant percer la lumière, produisant un effet de vitrail, comme l’indique le vers de la troisième strophe. Le geste de déplacer l’objet intervient ainsi dans l’appréhension générale, redonnant une signification à certains passages marqués par les métaphores de l’ombre et de la lumière, comme dans la dernière strophe.
Une poétique de l’écart
Le livre d’artiste, soit dans le cadre de l’édition commerciale, soit dans ses marges, serait pour Michel Butor un terrain d’expérimentation privilégié pour donner à voir la poésie, ou plutôt, pour la faire apparaître. Les matières, tout autant que les images – figures, traces, taches – s’offrent comme des « tremplins à l’esprit » [40], des supports pour les revêries poétiques, et, inversement, elles sont illustrées par l’écriture qui se déploie dans cet entre-deux du livre d’où « les mots jaillissent » [41]. Conçus à partir des images, certains poèmes comme « Lucidité » demeurent d’ailleurs intimement liés à leur support, n’existant que dans leur version inscrite dans le livre d’artiste.
Le rapport écriture-image qui s’y instaure, en oscillation constante, met en évidence le renversement des hiérarchies verbale et visuelle, de même que les contaminations éveillant l’iconicité de l’écriture poétique. Et, si l’intervention du poète est manuscrite, cela va représenter pour lui un double geste de transgression, voire de « déraison » [42]:
A partir du moment où mon texte entre dans le rectangle qui jusqu’à présent était réservé à l’artiste, était son privilège, mon écriture apparaît évidemment comme du dessin. Ce que j’écris va non seulement transformer la signification de ce que je regarde, mais son équilibre plastique, sa composition même. (...) L’écrivain alors se découvre peintre [43].
L’illustration telle qu’elle peut apparaître dans les travaux réalisés par Butor en collaboration avec Barceló et Youl, dépasse tout dualisme, prend place dans l’écart, rend visible la médialité de l’écriture, du moment où elle fait remonter à ses propres origines en tant que produit métissé, ancré sur son support, avec son potentiel de transgression.
[40] A. Breton, Manifeste du surréalisme, Paris, Gallimard, « Folio Essais », 1988, p. 47.
[41] M. Butor, « Pour écrire, j’écoute les images des artistes », art. cit.
[42] A.-M. Christin, L’Image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, (1995) 2001.
[43] M. Butor cité par L. Giraudo, Michel Butor, dialogue avec les arts, Op. cit., p. 10.
![]()

