
Byatt, Van Gogh et Matisse : rencontre
au-delà des mots.
Quand l’image plastique
s’invite dans le récit
- Alexandra Masini-Beausire
_______________________________
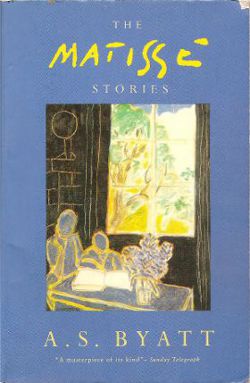
Fig. 2. A.S
Byatt, The Matisse
Stories, 1997,
première de couverture 

Fig. 3. A.S
Byatt, The Matisse
Stories, 1997,
quatrième de couverture 
L’échec avoué de la mise en scène de la pièce La Chaise jaune symbolise en partie tout le questionnement qui se met en place dans cette tétralogie. Cette pièce développe une problématique qui engage Alexander, comme le lecteur, sur une autre voie. Faire voir plutôt que d’écrire, semble nous susurrer le narrateur ! Toutefois, il ne faut pas s’y tromper, l’intention de Byatt n’est pas de minimiser les possibilités du langage mais de lui ménager des silences qui laissent le regard s’installer. Entre les bavardages incessants de Frederica et le silence contemplatif d’Alexander se trouve un point d’équilibre qu’il faut saisir. Van Gogh intervient ainsi pour guider le regard hors du lisible, le structurer dans les limites imposées par le silence de l’œuvre d’art. Un problème perdure toutefois : l’image plastique n’est pas matériellement présente dans le récit, elle est encore un flot de mots bourdonnant. Dans The Matisse Stories, Byatt réalise enfin ce que le Frederica Quartet n’osait pas entreprendre : faire entrer la matière picturale dans l’écriture.
The Matisse Stories : l’image plastique dans le récit.
Comparé
à l’ampleur du Frederica Quartet,
The Matisse Stories apparaît
d’une envergure bien modeste, et ce certainement à
dessein. Le roman est ici nouvelle, le flux verbal de la
tétralogie laisse place à trois histoires
d’une cinquantaine de pages au style
épuré. Le choix de ce genre concis
s’explique peut-être par la présence
concrète de dessins au côté du
récit. En effet, The Matisse Stories
met en jeu un effet d’emboîtement complexe et
profond, un véritable palimpseste à gratter. La
co-présence plastique texte-image implique
d’emblée une réflexion sur la place de
l’image, sur sa fonction dans le récit, sur sa
valeur symbolique mais aussi et surtout sur sa fonction
représentative.
Le titre, The
Matisse Stories, s’il ne fait écho
à aucune œuvre d’art, ne veut toutefois
rien déguiser de ses ambitions et place clairement
l’artiste peintre Henri Matisse à la
genèse et au cœur du recueil. Comme le
précise Catherine Mari, il reste ambivalent : il
« peut du reste s’entendre comme histoires
"à propos de" mais également "à la
manière de" Matisse » [24].
Peut-être devrions-nous l’appréhender
tout à la fois comme « Histoires
à propos, à la manière et pour
Matisse », ce dernier choix étant celui
du traducteur Jean-Louis Chevalier. Que Matisse soit le sujet du
recueil, son destinataire, sa source d’inspiration ou encore
son modèle, qu’importe finalement, constatons
simplement que ce n’est plus l’œuvre
d’art mais le peintre lui-même qui devient le point
d’origine de la fiction et va engendrer le travail
d’écriture. Byatt accorde une importance
particulière aux couvertures de ses
écrits ; dans le cas très particulier
des Histoires pour Matisse, il est
d’ailleurs difficile de penser que ce choix a
été laissé au hasard. Le paratexte
auctorial survient en effet comme un premier message crucial dans la
lisibilité de cette œuvre. Dans The
Matisse Stories, l’attention est
centrée toute entière sur la personne de
l’artiste avec, en première de couverture dans la
quasi-totalité des éditions
européennes, placé juste en dessous du titre, le
tableau de Matisse : Le Silence habité
des maisons (fig.
2). Le paratexte iconographique
s’insère ainsi juste en-dessous du titre et semble
s’intégrer dans l’appareil titulaire
comme un sous-titre, s’il est permis de désigner
ainsi une image. Tel qu’il est placé et
annoncé, le tableau est à
« prendre à la
lettre » et à intégrer
à la lecture. Cette première de couverture
apparaît au lecteur-spectateur comme une unité qui
invite à ouvrir l’œil et annonce
déjà la structure peu conventionnelle de ce
recueil. L’observation de cette peinture de Matisse en
paratexte anticipe d’ailleurs l’effet
d’emboîtement qui se met en place dans le livre. Le
Silence habité des maisons représente
une femme lisant avec un enfant devant une fenêtre. La
présence de l’objet
« livre » laisse place
à un effet de miroir évident, une mise en abyme
du lecteur qui le renvoie à sa propre action de
« lisant ». La fenêtre,
motif cher à Matisse, vient renforcer cet
enchâssement car elle ouvre, à
l’intérieur du tableau, une autre dimension
à envisager au sein même du triptyque. On retrouve
d’ailleurs ce tableau dans la seconde nouvelle du recueil au
titre évocateur, Art Work, qui apporte
une première explication à sa présence
en couverture :
En 1947 Matisse a peint Le Silence habité des maisons. On en trouve la reproduction dans le Matisse de Sir Lawrence Gowing, mais toute petite et en noir et blanc. Deux personnes sont assises au coin d’une table. La mère, peut-être, réfléchis, le menton appuyé dans sa main […] [25].
Le tableau est d’emblée nommé
par le narrateur pour ressurgir aux yeux du lecteur ;
l’élément paratextuel participe ainsi
d’une relation intratextuelle. L’incipit
d’Art Work décrit la
reproduction en noir et blanc du Silence habité
des maisons qui se trouve dans l’ouvrage de
l’historien d’art Lawrence Gowing. Ce retour
à l’iconographie, plastiquement
présente en première de couverture,
crée un système d’échos et
le dispositif intertextuel se creuse encore lorsque la parole est
donnée à Gowing au début du
récit. « Juxtaposée au
commentaire du Silence habité des maisons,
la nouvelle Art Work affiche sa dimension
autotélique »
[26],
précise
Catherine Mari. La fiction peut enfin prendre forme sur les fondations
de l’image plastique tout à la fois
décrite par l’ekphrasis et figurant plastiquement
en couverture. « Un silence
habité règne sur le 49, Alma Road […]
»
[27],
voici où tout
commence : au sein même
du tableau de Matisse.
L’appareil
paratextuel met encore au jour de nombreuses juxtapositions puisque Le
Nu rose et La Porte noire, toiles de
Matisse reproduites en quatrième de couverture (fig. 3)
de
l’édition anglaise, obéissent au
même processus que Le Silence habité
des maisons. Medusa’s Ankles
commence ainsi : « Elle était
entrée un jour parce qu’elle avait vu le Nu rose
à travers la vitrine »
[28].
La
conjonction « because », dans
le texte original, induit ce rapport de cause à effet qui
fait du tableau le point d’ancrage de la fiction.
Accroché dans un salon de coiffure dans l’incipit
de la nouvelle, il s’intègre dans le
décor : « Le tableau, ainsi mis
en abyme dans la nouvelle qu’il a provoquée, est
doublement mis en relief à la fois dans l’espace
littéral du salon et aussi dans l’espace
figuré du texte »
[29].
Enfin, le dernier
élément paratextuel iconographique, La
Porte noire, intervient dans The Chinese Lobster
mais le processus, cette fois-ci, s’opère a
contrario puisque le récit précède
l’évocation du tableau comme pour mieux
s’y installer. Le paratexte renvoie le texte à
l’image et réciproquement dans un jeu intertextuel
ininterrompu ; à cet égard, il
mérite d’être traité comme un
iconotexte à part entière.
[24]
C. Mari, « De tableau en histoire,
d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The
Matisse Stories de A.S Byatt », actes du
colloque de la SEAC (Société d’Etudes
Anglaises Contemporaines), Paris Sorbonne, 1996, dans Etudes
Britanniques Contemporaines n° 12, Presses Universitaires de
Montpellier, 1995, p. 31.
[25]
Histoires pour Matisse, Op. cit.,
p. 41 / Dans le texte original : « In
1947
Matisse painted Le Silence habité des maisons.
It is reproduced in Sir Lawrence Gowing’s Matisse,
only very small and in black and white. Two people sit at the corner of
a table. The mother, it may be, has a reflective chin […] »
(dans The Matisse Stories, Op.
cit., p. 31).
[26]
C. Mari, « De tableau en histoire,
d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The
Matisse Stories de A.S Byatt », art.
cit., p. 31.
[27]
Histoires pour Matisse, Op. cit.,
p. 42 / Dans le texte original : « There is
an inhabited silence in 49 Alma
Road […] » (dans The
Matisse Stories,
Op. cit., p. 32).
[28]
Histoires pour Matisse, Op. cit.,
p. 9 / Dans le texte original : « She had walked in one day
because she had seen the Rosy Nude through the plate glass
»
( dans The Matisse Stories, Op. cit.,
p. 3).
[29]
C. Mari, « De tableau en histoire,
d’histoire en tableau : le lecteur-spectateur dans The
Matisse Stories de A.S Byatt », art.
cit., p. 32.


