
L’image dans le récit.
La Cage ou la mise en abyme iconique
- Claire Latxague
_______________________________
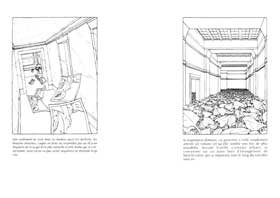
Fragmentation du récit
Le souffle de la matière
La longue séquence qui occupe la place centrale de La Cage se déroule à l’intérieur du musée que renferme le générateur (pp. 56-144). D’après les carnets tenus par Martin Vaughn-James lors de la conception de son œuvre, il s’agit de la troisième partie du récit qu’il intitule « The Crisis-The Museum » [13]. Crise du récit, de la chronologie des événements qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur, dans le décor néo-classique du musée. Son architecture est représentée tantôt en ruines, tantôt intacte, dans une alternance qui rappelle l’ascension du tertre. Ainsi, toute la séquence du musée étire sur près de la moitié du livre le même rythme passé/futur, idéal/réel que celui de la séquence de la pyramide. Une équivalence s’établit alors entre ces deux figurations architecturales d’une même idée de sanctuaire par une effet de rime ou de synonymie iconique qui pourrait entrer dans la typologie ricardoulienne des « opérations transitaires simples » [14] qu’il expose dans Le Nouveau Roman.
La séquence s’ouvre et se referme sur deux doubles pages qui se font écho tant par l’image que par le texte (pp. 54 et 144). Elles se renvoient l’une l’autre à travers l’image de portes fermées ou murées, ainsi que par l’évocation, dans le texte, d’une respiration : « silence cédant peu à peu la place au flux et au reflux de l’inspiration et de l’expiration » (p. 54) ; « air aspiré / et expiré » (p. 144). Elles figurent donc les limites du musée clos sur lui-même comme lieu d’où provient le souffle du livre. Cependant, par la mise en exergue du mur qui condamne la porte, encadré comme s’il s’agissait d’une toile (p. 54), l’image semble dire que le début de la séquence est déjà sa fin, que tout est déjà joué d’avance.
Tourner les pages du musée correspond à parcourir ses pièces et ses couloirs, toujours accompagné par le son de la respiration : « de nouveau la respiration, remplissant le corridor de son bruit monotone et insistant, la succession d’inspirations et d’expirations formant une sorte d’incantation » (p. 56) ; « la respiration s’accélère, bouffée d’air aspiré presque aussitôt expulsé ». Ce souffle qui remplit l’espace donne vie aux murs du musée et à son atmosphère à travers trois formes d’action : la prolifération, la circulation et la dispersion.
Prolifération, tout d’abord, de la matière dans les corridors. À plusieurs moments, le sol du musée se peuple de monolithes, de végétation, de poteaux ou encore d’encre et de briques. La force proliférante contamine le sol et les murs eux-mêmes. Par terre, le motif du carrelage mute à chaque page par ajout de lignes supplémentaires au motif du début. Aux murs et au plafond les moulures se surchargent et se compliquent de plus en plus, comme si la matière architecturale pouvait faire proliférer ses cellules. Ainsi, les pages de la séquence du musée, progressivement envahies de matière, éclairent rétrospectivement l’incipit où les pages blanches en enfilade se remplissaient d’encre.
Le souffle qui fait proliférer la matière nourrit également la circulation, non pas au sol mais en apesanteur, d’objets et de matières. Sur un même diptyque peuvent cohabiter ces deux images de prolifération et de circulation, l’une dans un musée en pleine expansion, l’autre dans ce même lieu, cette fois-ci, en cours de décrépitude (fig. 7). Dans les couloirs qui se fissurent et s’écaillent, un air mystérieux fait s’envoler des feuilles ou photographies sur lesquelles se distinguent des fragments d’images déjà vues. Il s’agit de dessins des vêtements que nous avons aperçus dans la chambre. Par cette mise en abyme picturale, papier et tissu fusionnent. Tandis qu’ils figuraient la peau dans la chambre, ils rendent à présent tangible le souffle qui les fait s’envoler.
Ce souffle peut parfois atteindre une grande violence et provoquer l’envolée d’objets et de matières plus importants. Le récit est rythmé par ces jaillissements inattendus : des portes démontées semblent éclater en l’air (p. 60), un flot d’encre surgit dans le couloir (p. 72), des feuilles de papier transpercées (p. 96) et des briques (p. 118) sont propulsées d’une pièce à l’autre comme soufflées par une explosion. Cette dispersion des matériaux qui constituent le récit signifie sa fragmentation, l’explosion de son unité en particules. Il s’agit d’une mise en évidence de la composition de l’œuvre par combinaison d’objets, dont chacun devient métonymie de l’ensemble. Chaque feuille, brique, morceau de bois renvoie à chaque page du livre, au cadre dans la page, au moindre point ou ligne d’encre, peut-être même à chaque mot du texte, « menu fragment sans importance » [15] qui serait à l’origine de l’œuvre. Mais, comme le dit Johan Faerber, lorsqu’il étudie l’herméneutique du Nouveau Roman à travers la ruine, « la métonymie ne peut rester métonymie […] la métonymie s’ouvre logiquement à la métaphore et est guettée par un devenir allégorique » [16].
Je ferais ici référence à l’allégorie d’Osiris merveilleusement déployée par Jean Ricardou dans Nouveaux problèmes du roman [17]. Après avoir retrouvé le corps d’Osiris dispersé, sauf le pénis, Isis renferme chaque fragment dans autant de statues à l’effigie de son frère qu’elle enterre à différents endroits pour lui offrir plusieurs sépultures. C’est ce que Jean Ricardou nomme « fable de la dissémination phrastique » qui fait fructifier tout fragment de la phrase : « Ainsi des fragments osiriens : chacun sert de départ à un nouvel Osiris funéraire » [18]. Dans La Cage, la matière disséminée germe dans chaque page. Bien que le récit semble éclaté, une autre force résiste qui fait œuvre et tient ensemble les morceaux dans sa machinerie : « la cage a survécu / insensible au chaos et aux détériorations » (p. 74).
L’auteur-machine
Ainsi que nous l’avons vu dans la première partie du récit, la figure de l’auteur est également disséminée dans la séquence du musée. Cet auteur a une voix qui se laisse entendre parfois. Une voix descriptive qui commente la genèse de l’œuvre et nous signifie qu’elle se construit sous nos yeux. Il la critique : « non ça ne va pas, cette séquence se déroule trop vite » (p. 58), « non, tout ça ne va pas, toute cette séquence progresse bien trop lentement » ; tente de l’interpréter : « à moins qu’il ne fasse de nouveau nuit » (p. 116) et en décrit le style : « l’impression est celle d’artifice, renforcée, peut-être, par le traitement maniéré dont il est constamment fait usage » (p. 116). Une dynamique est lancée qu’il semble ne plus pouvoir contrôler, le réduisant au rôle de spectateur. À moins qu’il ne s’agisse du récit lui-même, commentant sa propre narration, voulant parfois lui résister. Quoiqu’il en soit, nous avons encore affaire à une instance bicéphale, surgie du dialogue entre les images de chaque diptyque, entre texte et image, entre récit et narration, entre œuvre et auteur.
L’on retrouve également les objets qui caractérisaient l’auteur dans les premières pages : les « cinq accessoires » (p. 122) ou meubles, des vêtements, des feuilles vierges ainsi que des instruments de mesure et d’enregistrement. Dans le musée, tous ces éléments vont faire corps pour marquer le récit d’une présence humaine. Un lit en fer apparaît, tout d’abord, dans une pièce du musée (p. 62) dont les draps, en se retirant progressivement, laissent voir une paire de jumelles et un casque d’écouteurs (p. 66). Ces objets répondent, en négatif, au couple haut-parleur/projecteur de la machine décrite par le texte à plusieurs reprises. Nous retrouvons les attributs de la perception et, peu à peu, d’autres objets qui formaient la haie d’honneur vers la pyramide dans l’incipit et qui sont, ici, représentés sous leur forme solide.
[13] Voir les détails sur la genèse de l’œuvre (choix des lieux, plan du récit) dans « À la recherche d’une structure », dans Thierry Groensteen, Op.cit., pp. 37-50.
[14] Voir Jean Ricardou, « Le récit dégénéré », dans Le Nouveau Roman, Paris, Seuil, « Points », 1990, pp. 86-100.
[15] A. Robbe-Grillet, « Temps et description dans le récit d’aujoud’hui », Op.cit., p. 127.
[16] J. Faerber, avant-propos de « Les ruines comme herméneutique en déréliction », Le Nouveau Roman en questions, nº 6, « Vers une écriture des ruines ? », vol. 1, Caen, Lettres modernes Minard, 2008, pp. 95-96.
[17] Voir le chapitre « Le dispositif osiriaque », dans Jean Ricardou, Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil, « Poétique », 1978, pp. 179-243.
[18] Ibid., p. 196.



