
Les mots et leurs visages
Sur L’invisible parole de Pierre Chappuis
- Marianna Marino
_______________________________
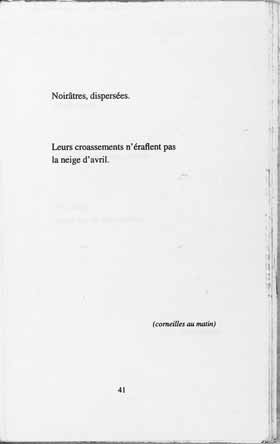
L’état de fragmentation que l’on relève dans les poèmes de Chappuis dérive d’un souci asyntactique, où la discontinuité devient principe de création, comme le dit l’auteur lui-même :
Discontinuité, mais prise dans un mouvement ; rupture et effacement de la rupture ; fragmentation – chaque partie a sa vie propre, d’où sourd l’appétit d’un tout ; discours qui ne va pas en ligne droite, mais, d’une manière ou d’une autre, enfoui, refait surface [33].
Chaque fragment exprime alors la nostalgie d’une totalité (désormais absente – et, par conséquent, invisible), et c’est par ce malaise des paroles que le poème peut se réaliser : non point d’une façon linéaire, mais suivant les virages auquel son tissu verbal donne lieu.
Plusieurs éléments contribuent à créer cet effet de morcellement, dont le plus évident dans le recueil analysé est sans aucun doute la présence des parenthèses. L’auteur les définit de la façon suivante, en soulignant leur collaboration avec les autres dispositifs de désagrégation (c’est-à-dire l’italique et les tirets) :
Ecrans qui creusent un écart sans séparer, obstacles mineurs, viviers, poches intérieures de la phrase qui, malgré les entraves, progresse, coule comme une eau, ici s’accumulant, là se précipitant dans un goulet. (…)
A l’endroit de ces minces cloisons, toujours doubles, tantôt à peine perceptibles, tantôt quasi infranchissables, la sensibilité est à exercer comme une manière de passer, de glisser qui fait éprouver d’être retenu, mais provisoirement et, tout autant, mené.
L’italique (pour mon compte) dérange l’équilibre du texte, son unité. Non moins les tirets, qui tranchent trop nettement, isolent, mettent de côté, font admettre qu’on passe brusquement d’une chose à une autre. Un seul peut suffire ; le sentiment de désarticulation s’accroît d’autant.
La parenthèse promet le contraire, aplanit, arase, devient affleurement, même s’il y a bond, ne dit quelque chose de radicalement autre qu’en l’insérant dans un discours. Elle est une incision dans la chair de la phrase, une échancrure, une faille par où monte une voix intérieure (là, au besoin, l’italique), voix étrangère mais qui n’use d’aucune autorité, presque clandestine, en tout cas étouffée, allusive, murmurant. (…)
La parole ainsi est mise en cause de l’intérieur par une autre parole subconsciente dont la discrétion rappelle celle des moindres signes, la plupart inaperçus, venus de notre nuit, de nos rêves, venus on ne sait d’où, aussi fugaces qu’inopinés [34].
Selon Buchs, les parenthèses sont le symptôme, au début de la production de Chappuis, d’une recherche poétique se faisant sur la page elle-même et se réalisant à travers la co-présence d’une multiplicité de voix : « Les parenthèses permettent souvent de visualiser ces voix, qui ne dialoguent pas, mais se chevauchent » [35]. Ces parenthèses marquent par ailleurs la respiration des mots, simulée par « un mouvement symbolique d’ouverture puis de fermeture » [36].
L’utilisation sélective de la ponctuation est une autre stratégie significative d’une approche déterminée du langage. Prononcer une parole invisible, c’est un vœu d’humilité par rapport au langage car il s’agit d’une parole qui reconnaît sa subordination à des images jamais dicibles dans leur pleine vigueur, couleur, et qui se limite à dessiner leur pourtour, leur cadre verbal et virtuel. Pour cette raison, elle devient parole hésitante, rompue, fragmentée par l’épreuve de l’expression.
Dans le cas particulier de L’Invisible parole, on pourrait dire que les parenthèses miment aussi les cadres des tableaux, mais dans une fonction tout à fait inverse : elles referment en effet la représentation, ou mieux, la re-présentation, c’est-à-dire le contexte, le cadre constitué par la réalité extérieure aux peintures, tandis que les images des tableaux jaillissent et s’étendent sans limites.
D’un point de vue typographique, les poèmes de ce recueil se présentent encore comme des proses, des blocs compacts. Le texte de Chappuis subit pourtant un processus de désintégration à cause duquel il s’effiloche jusqu’à ne composer que des lignes perdues sur la page. L’auteur emploie toutes les consistances possibles offertes par la matérialité de la langue : toute composition linguistique est doublée d’une composition picturale, au sens où les mots se disposent sur la page comme sur une toile. C’est le cas, par exemple, de Pleines marges (recueil publié chez Corti en 1997). Tous les poèmes faisant partie de cette œuvre se terminent par une brève note en force de corps réduite située à l’extrémité inférieure droite de la page – note mise en évidence d’ailleurs par l’utilisation des parenthèses et de l’italique (fig. 9). Le poème maintient ainsi une forte qualité picturale, obtenue par le travail sur la matière graphique du texte lui-même.
Un autre auteur où le contact avec les arts plastiques côtoie une expérience typographique originale de la poésie est André du Bouchet, auquel Chappuis a consacré un écrit [37]. Ses œuvres offrent au regard du lecteur une matière complexe, où l’écriture semble se poser tout d’abord en tant que matière :
En supprimant le foliotage, en introduisant la respiration et l’impulsion des blancs, en réinvestissant les marges, en travaillant sur la typographie, l’interlignage et l’interlettrage, André du Bouchet réinvente la page : la mesure n’est plus celle de la page, mais celle de la double page, qui, dans l’oubli de l’écrit que le blanc immerge, devient l’équivalent plastique d’une toile [38].
Chez du Bouchet aussi, la confrontation avec la peinture se charge d’une syntaxe très fragmentée, interrompue fréquemment par des parenthèses, des tirets, des points de suspension :
… sur la poussé du visage, de nouveau ( traits affleurant, comme le vent
se plaque ) … incessamment ce coup d’arrêt des parois de la paupière,
arrêté à une face, puis, sur la poussée de cette face ( ou, sous cette poussée )
pareille à un coup de froid, ou à un coup de sang, un coup de chaleur, traits distinctifs élargis – sans que le centre se dissipe – comme perdus…
réintégrant cette épaisseur stabilisée dans sa crue [39].
La peinture de Pierre Tal Coat qui inspire ce passage empêche de considérer l’œuvre d’art en tant qu’objet fixe destiné au regard et à la contemplation. Dans ce passage, la matière picturale est en mouvement, incessante et inachevée. Parfois, la présence d’un observateur est plus évidente, mais elle ne réduit nullement le rôle des formes et des couleurs :
En face de peintures de Bram van Velde réunies en grand nombre, l’épanchement du trop-plein de la couleur allant son chemin, moi-même cheminant du mien, passé, je me souviens, comme à côté, puis au loin. Je me souviens de la disparition de toute figure dans la chaleur de ce passage précipité, laissant à chaque pas sur le regret de n’avoir pas fait, et même à nouveau, demi-tour ( le tour entier ne pouvant être effectué que beaucoup plus loin ) . Mais de face, cependant, aller – comme la couleur – son chemin, est aussi se soustraire à l’immobilité du rapport de face qui arrête les figures… Moi-même soustrait pour une part – comme, en avant de moi, ma tête latérale quand je la dépasse – l’œil alentour déjà. Comme au travers déjà [40].
La peinture est une matière vivante : pour cette raison, elle ne peut pas être véritablement décrite. Mais grâce à la rencontre constante avec la parole, les images imposent un détour qui permet une possibilité de regard.
Le recueil de Chappuis suggère une relation intéressante entre le texte et l’image, où les deux semblent se chercher sans cesse dans ce que Ponge appelait Le Drame de l’expression :
Mes pensées les plus chères sont étrangères au monde, si peu que je les exprime lui paraissent étranges. Mais si je les exprimais tout à fait, elles pourraient lui devenir communes.
Hélas ! Le puis-je ? Elles me paraissent étranges à moi-même. J’ai bien dit : les plus chères…
Une suite (bizarre) de références aux idées, puis aux paroles, puis aux paroles, puis aux idées [41].
Cette parole lacérée est obligée de faire face au silence qui l’entoure et qui parfois risque de l’engloutir. Si Ponge relève une forme de lutte entre les paroles et les idées, chez Chappuis le même phénomène concerne le rapport entre la parole et l’image qu’elle contemple. Le résultat, c’est un bizarre (et synesthésique) renversement de qualités : le mutisme affecte les personnages des portraits évoqués, tandis que la parole devient invisible. La parole que Chappuis cache dans ces tableaux n’arrive enfin à dire ces visages qu’à travers une œuvre au noir où le silence et l’invisibilité rétablissent leur fonction expressive.
[33] P. Chappuis, La Preuve par le vide, Paris, José Corti, 1992, p. 47.
[34] Ibid., pp. 53-55.
[35] A. Buchs, « Pierre Chappuis : un poète dans les marges », Versants. Revue suisse des littératures romanes, n°35, 1999, pp. 79-80 (note 3).
[36] Ibid., p. 83.
[37] P. Chappuis, Deux essais. Leiris/du Bouchet, Paris, José Corti, 2003.
[38] V. Martinez, Aux sources du dehors : poésie, pensée, perception, dans l’œuvre d’André Bouchet, thèse de doctorat : langue, littérature et civilisation françaises, Paris III, 2008, p. 280.
[39] A. du Bouchet, Un jour de plus, dans le catalogue de l’exposition « Tal Coat », Grand Palais, 4 février-5 avril 1976, Centre national d’art et de culture Georges Pompidou, p. 38.
[40] A. du Bouchet, La Couleur, Paris, Le Collet de Buffle, 1975 (n. p.).
[41] F. Ponge, Œuvres complètes, I, édition publiée sous la direction de Bernard Beugnot, avec, pour ce volume, la collaboration de M. Collot, G. Farasse, J.-M. Gleize, J. Martel, R. Melançon et B. Veck, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1999, pp. 175-176.



