
Peindre la lecture, lire la peinture
- Nausicaa Dewez
_______________________________
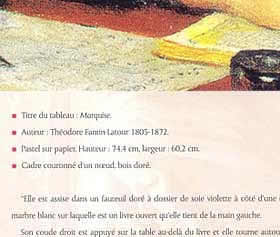
Fig. 2. Colette Nys-Masure, Célébration de la lecture,
pp. 6 et 7 (détail) 

Fig. 3. Colette Nys-Masure, Célébration de la lecture,
pp. 18 et 19 (détail) 
Le paratexte s’accroît encore d’un second texte introductif, titré « Décrire, suggérer », mais non
signé. Si dans le premier texte, l’auteure explique sa conception de la lecture - celle qui se donne à voir dans les tableaux qu’elle a choisis et celle qu’elle
pratique elle-même comme spectatrice de ces œuvres picturales -, « Décrire, suggérer » précise en revanche la manière dont elle
conçoit l’écriture de textes traitant de peintures : elle affirme vouloir « suggérer sans décrire », « [t]rouver un angle
surprenant », et prévient donc son lecteur que ses textes ne ressembleront pas à un « relevé minutieux »
(fig. 2) [13].
Le paratexte (abondant) mine l’égalité entre mots et images, vers laquelle tendent au contraire la disposition et la composition des couples
texte / tableau. Cette absence de hiérarchie est par ailleurs également contestée par une différence fondamentale entre les arts littéraire et pictural : les
images présentes dans Célébration ne sont en effet que des reproductions de l’œuvre originale, à l’inverse des textes de Nys-Mazure
(et dans une certaine mesure, de la citation de Certeau). Pour le dire avec Bernard Vouilloux (à la suite de Nelson Goodman), la peinture appartient aux arts
« autographiques » [14] : « même [l]a plus exacte reproduction n’a pas (...) statut
d’authenticité » [15].
À l’« ère de la reproductibilité technique » (W. Benjamin), les reproductions de tableaux sont certes
colorisées et d’une qualité excellente. Toutefois, les progrès techniques ne peuvent empêcher que la reproduction photographique d’une œuvre picturale ne
soit pas cette œuvre d’art, dont elle n’offre qu’une représentation. Les multiples exemplaires d’un texte littéraire, par contre, pour autant
qu’une édition soit légalement validée, ont tous valeur d’œuvre authentique. Bien qu’il conjoigne texte et image, le livre de Nys-Mazure se conforme au
régime littéraire : tous les exemplaires ont même valeur d’authenticité et ne sont pas à considérer comme reproductions appauvries d’un
original qui serait seul authentique. Cette différence fondamentale entre littérature et peinture n’est cependant pas exploitée par l’écrivaine, qui emploie
même simplement le terme « tableaux » pour désigner les reproductions placées dans le livre. Pourtant, leur limite (en particulier dans le rendu de la
matière picturale) échappe d’autant moins, qu’on peut, dans le même livre, les comparer avec les textes, que la reproduction en multiples exemplaires
n’altère pas.
Si les couples formés par un tableau et un texte tendent vers l’égalité entre les deux éléments, celle-ci se trouve
néanmoins ébranlée, tant quantitativement (le paratexte n’ayant pas d’équivalent pictural, il y a plus de textes que d’images) que qualitativement
(puisque l’auctorialité est du seul côté de la littérature). Les textes sont en fait sans pendant pictural dans les lieux du livre qui impliquent un discours
rationnel ; raison et organisation y demeurent, classiquement, l’apanage des mots [16].
Écrire des tableaux
Faisant suite aux deux textes introductifs, le cœur même de Célébration de la lecture est une succession de couples
tableau / texte, déclinant la thématique de la lecture. Dès l’introduction, l’auteure dévoile l’ambition des textes qu’elle consacre aux
œuvres picturales choisies : elle souhaite« prête[r] [s]es mots [aux tableaux] pour qu’ils vivent différemment »
[17]. Démarche empreinte d’humilité, donc, qui met le texte au service du tableau dont il s’inspire. Cependant, Nys-Mazure ajoute
aussitôt vouloir « suggérer sans décrire, ménager un point de vue original, une chute » [18] : ses
écrits ne doivent pas être des doubles stériles des tableaux, mais traduire la singularité du regard de la femme de lettres sur ces œuvres picturales.
L’introduction révèle une oscillation de l’écrivaine entre une volonté de servir les toiles, par rapport auxquelles ses textes restent seconds, et
une recherche d’autonomisation.
Elle expose là le dilemme inhérent à toute description d’œuvres d’art, que Jacqueline Lichtenstein définit comme
la nécessaire conciliation entre une question « philosophique, celle de la vérité » et une question « rhétorique, celle des
effets » [19]. Pour la première, le texte, parce qu’il décrit un tableau - c’est-à-dire un référent
réel, existant hors du texte -, doit en rendre compte avec exactitude et fidélité. La seconde envisage au contraire la description comme un texte autonome, une
œuvre littéraire indépendante de son référent extratextuel. Dans cette perspective, le texte doit tendre vers la perfection stylistique, laquelle signifie que le
lecteur est censé avoir l’impression de voir l’objet décrit (dont le degré de fidélité avec l’objet à décrire importe
peu). Tous les textes de ce type - ceux qui composent Célébration de la lecture y compris - sont donc aimantés par deux polarités contradictoires, une fonction
utilitaire et une recherche du statut d’œuvre d’art [20].
J. Lichtenstein affirme encore que l’émancipation du texte par rapport à son référent est d’autant plus aisée que
l’œuvre d’art est invisible pour le lecteur de la description :
La critique d’art se nourrit (...) de l’absence de l’objet pour produire des textes qui existent de manière autonome, comme des textes littéraires, c’est-à-dire qui sont eux-mêmes des œuvres d’art [21].
Dans le cas de Célébration, c’est pourtant le rapport in praesentia entre texte et image qui justifie l’autonomie
du texte. Si celui-ci peut outrepasser le strict domaine de ce que le tableau donne à voir, ce n’est pas parce que le lecteur se trouve dans l’incapacité de comparer le
texte à la peinture, mais bien parce qu’il peut découvrir cette dernière de ses propres yeux, via les reproductions placées dans le livre. À charge
de l’écrivaine de dire, à propos du tableau, autre chose que ce que le lecteur peut voir.
Précisément, l’émancipation du texte vis-à-vis de son référent - condition de sa littérarité -
passe par l’expression de ce que le tableau ne montre pas. Cet invisible est de nature diverse.
Il est tout d’abord du domaine de l’audible. Plusieurs textes ont en effet pour objet les paroles échangées par les personnages
peints, et leur écoute. La Leçon de lecture de ter Borch [22], par exemple : « [la femme peinte]
[é]coute-t-elle ânonner l’écolier ou, lasse de cette tâche fastidieuse, se laisse-t-elle dériver ? »
[23]. Ici, ce n’est pas tant le contenu des paroles que leur existence même qui est mise en scène. Pour d’autres tableaux, par
contre, le texte tout entier est la transcription des paroles que l’auteure imagine dans la bouche d’un personnage. C’est le cas du commentaire des Quakers de Van
Strydonck (fig. 3) [24] :
Quand tu étais enfant, c’était moi qui te lisais pour t’endormir ou t’emporter par delà les murs de
notre maison. Aujourd’hui, aveugle, limitée dans mes déplacements, je jouis de ta voix aux intonations familières apprivoisant le texte pour m’offrir
l’écho d’autres existences.
Ce midi, la lettre que tu déchiffres m’apporte une bouffée d’Europe, de tous ceux-là si loin. Si près de mon cœur
toujours vif [25].
[14] B. Vouilloux, Langages de l’art & relations transesthétiques, op. cit., p. 28.
[15] N. Goodman, Langages de l’art. Une approche de la théorie des symboles, cité dans Ibid., p. 28.
[16] Les critiques adressées à la peinture, depuis Platon, lui reprochent d’ailleurs précisément son défaut de rationalité. Celui-ci est généralement attribué à la couleur, tandis que le dessin constituerait au contraire la part rationnelle de la peinture. Voir J. Lichtenstein, La Couleur éloquente. Rhétorique et peinture à l’âge classique, Paris, Flammarion, « Champs », 1999.
[17] C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 5.
[18] Ibid., p. 7.
[19] J. Lichtenstein, « La Description de tableaux : énoncé de quelques problèmes », dans La Description de l’œuvre d’art. Du modèle classique aux variations contemporaines. Actes du colloque organisé par Olivier Bonfait, coordination éditoriale A.-L. Desmas, Paris, Somogy, « Collection d’histoire de l’art de l’Académie de France à Rome », 2004, p. 297.
[20] Ces deux visées ne sont, en réalité, pas toujours contradictoires. On sait ainsi que Baudelaire était convaincu que « le meilleur compte rendu d’un tableau pourra être un sonnet ou une élégie. » (Ch. Baudelaire, « Salon de 1846 », dans Œuvres complètes II, texte établi, présenté et annoté par Cl. Pichois, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 418). Baudelaire suggère donc que le compte rendu le plus fidèle d’un tableau n’est pas celui qui le décrit minutieusement, mais celui qui, par sa littérarité, suggère les qualités artistiques de son référent.
[21] J. Lichtenstein, « La Description de tableaux : énoncé de quelques problèmes », art. cit., p. 300.
[22] Gerard. ter Borch, La Leçon de lecture, s.d., Paris, Musée du Louvre.
[23] C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 43.
[24] Guillaume S. Van Strydonck, Floride, les Quakers, nouvelles d’Europe, 1886, collection particulière.
[25] C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 19.


