[30] Claudine Hervouët, Jacques Vidal-Naquet, « Le documentaire aujourd’hui, entre permanence et renouvellement », dans Françoise Legendre (dir.), Bibliothèques, enfance et jeunesse, Editions du Cercle de la Librairie, 2015 (en ligne. Consulté le 4 août 2022).
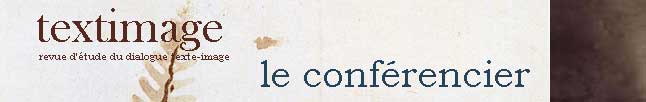
Portraits de pays en collection pour
la jeunesse dans le fonds du CRILJ
- Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide-Jager
_______________________________
Si l’enfant/adolescent est une porte d’entrée, on ne le suit pas forcément dans son quotidien. Ainsi pour la jeune fassie, il n’est quasiment pas question d’école (seule une mention d’une école privée et de son probable avenir d’étudiante à l’étranger). Les activités du jeune Reda ne sont pas vraiment mentionnées (tentation de se livrer, comme son frère, à de petits trafics) ; pour Anissa, seulement, le partage entre fréquentation irrégulière de l’école et garde du troupeau est précisé et même détaillé, suggérant sans l’expliciter le taux de scolarisation encore très bas au Maroc. En revanche, il peut être question des activités des autres membres de la famille : le père de Leila est un homme d’affaire dans le tourisme, ce qui donne lieu à précision sur le tourisme au Maroc, sur les infrastructures ; le frère de Reda est un petit trafiquant, d’où quelques développements sur les trafics, la contrefaçon et la production de cannabis ; la situation de la petite paysanne du Haut-Atlas, qui travaille déjà comme une adulte, engendre des développements sur l’agriculture traditionnelle et sur sa fragilité.
Les informations sont ainsi agrégées aux situations des personnages : la situation du jeune Réda dans le bidonville permet aussi de revenir sur l’histoire de sa famille, originaire du Sahara occidental ou encore sur la montée de l’islamisme dans les quartiers pauvres, contrebalancée par un apport sur les « valeurs de l’Islam » défendue par la mère du jeune garçon. L’amitié entre la jeune fassie et une amie juive marocaine permet un apport de savoir sur l’histoire de la présence juive au Maroc.
Si l’ouvrage cherche à rendre compte du point de vue des enfants, il est souvent un prétexte à un développement informatif beaucoup plus surplombant.
Malgré une maquette finalement assez figée, le fonctionnement par agrégation crée un parcours, certes linéaire dans le processus de lecture, mais qui évite l’impression de présentation systématique et répétitive qui aurait pu être imposée par des entrées similaires pour chaque enfant, ce qui n’est pas tout à fait le cas. Chaque partie consacrée à un des enfants ne suit donc pas le même parcours, même si l’on retrouve des éléments qui se donnent comme des incontournables : ainsi chaque présentation s’achève sur l’évocation d’une fête traditionnelle, marquant l’attachement de chaque communauté à des traditions.
L’enfant-prisme qui guide l’entrée dans ces différents espaces socio-culturels est présenté de manière habile et relativement efficace dans un réseau de relations, de déplacements et de territoires qui permet de rendre compte de manière intéressante de la diversité du pays et d’espaces qui ne sont pas toujours des lieux partagés, à l’image de la société marocaine où la séparation des classes et des communautés reste très marquée.
Nous avons été finalement surprises de l’ampleur de notre corpus dans ces années 1980-2010 sur les portraits de pays. Il correspond néanmoins à l’explosion du genre documentaire en littérature de jeunesse remarquée par Claudine Hervouët [30]. Il est assez notable de voir que les éditeurs historiques de la littérature de jeunesse font des propositions, tout comme des éditeurs plus confidentiels ou inattendus. Les premières propositions de notre corpus tendent vers une forme d’exotisme dans le choix des territoires avant qu’une diversification et une exhaustivité des lieux se fasse jour. Dès lors, l’ambition est davantage celle d’un savoir objectif prenant en charge des dimensions sociales, culturelles et parfois politiques : le pays doit être approché dans sa complexité et dans son altérité avec des portraits croisés et multiples au service d’un même territoire, dont l’illustration photographique et dessinée rend compte.
La spécificité du « portrait de pays » en littérature de jeunesse tient aussi à la figure de l’enfant toujours présente, à une exception près. Les enfants peuvent être fictifs ou réels. Cette donnée n’influe finalement que peu dans l’approche : l’enfant s’avère finalement un prétexte, permettant l’identification du lecteur cible. L’enfant n’est pas toujours le guide attendu de son pays mais reste souvent un artifice dans la narration qui manque d’un fil conducteur pour qu’on s’approprie pleinement son quotidien. Si l’album documentaire programme un lecteur, quel est-il ? Un lecteur curieux d’ailleurs, un lecteur avide de connaissances mais depuis peu aussi un lecteur voyageur en mesure de venir à son tour habiter ces lieux et cet espace. Le développement du tourisme, de moyens de transport low cost, d’hébergements accessibles à toutes les bourses et des voyages en famille produit un sous-genre peut-être, en tout cas une forme éditoriale : les guides de voyage pour enfants, intéressants à analyser à leur tour pour le monde qu’ils dessinent et pour la conception de l’enfance et de l’enfant voyageur qu’ils suggèrent.
Annexe 1 : tableau des collections
| Collection Editeur Date |
Enfants de la terre Père Castor (1948-1983) |
Enfants du monde Nathan (1952-1978) |
Enfants du monde PEMF (2000-2006) |
Enfants d’ailleurs La Martinière Jeunesse (2005-2013) |
| Afrique | 3 (18%) | 4 (17%) | 8 (30,7%) Egypte, Maroc, Madagascar, Algérie, Masaï, Sénégal, Tunisie, Touarègue |
7 (25,9%) Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Madagascar, Rwanda, Maroc, Egypte |
| Amérique | 6 (35%) | 7 (29%) | 7 (26,9%) Cuba, lac Titicaca, Brésil, Pérou, Equateur, Bolivie, Inuit |
6 (22,2%) Brésil, Argentine, Canada, Etats-Unis, Guatemala, Cuba. |
| Asie | 1 (6%) | 7 (29%) | 8 (30,7%) Vietnam, Mhong-Fleur, Indonésie, Gange, Himalaya, Cambodge, Laos, Malaisie |
5 (18,5%) Chine, Inde, Japon, Indonésie, Vietnam |
| Europe | 7 (41%) | 5 (21 %) | 2 (7,6%) Espagne, Grèce |
4 (14,8 %) Russie, Pologne, Roumanie, Espagne |
| Antarctique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Océanie | 0 | 1 (4%) | 0 | 1 (3,7%) Australie |
| Moyen-Orient | 1 (3,8%) Turquie |
4 (14,8 %) Jérusalem/Bethléem, Iran, Liban, Turquie |
Pour ce tableau, nous avons repris les données proposées par Christophe Meunier dans son article « Terre des hommes, enfants de la terre. Quand le Père Castor se mêle de géographie » (2/5), Les Territoires de l’album, espace et spacialité dans les albums pour enfants, 2016 (en ligne. Consulté le 4 août 2022), auxquelles nous avons adjoint nos informations et nos calculs concernant deux des collections que nous présentons dans cet article.