Pourtant, dans ces quinze petites formes sombres (ou dans ces quinze variations sur une telle forme) et aussi résistantes à la nomination stable que celles-ci puissent demeurer, certaines réminiscences insistent davantage. Car, décidément, ces résidus recroquevillés n’ont que peu à voir avec le « buste en bronze » proposé par Tisserant. Buste dont la pensée paraît, plutôt que par la forme, suscitée par la gloire des noms cités, qui sont tous, sans exception, ceux de « grands auteurs » classiques : de Plaute à Lucain, Martial ou Juvénal, en passant par Térence, Phèdre, Lucrèce, Catulle, Virgile, Horace, les élégiaques Properce, Ovide et Tibulle, le romancier Pétrone. Statufiables, donc, et parfois statufiés dans les manuels de littérature latine. Seule peut-être la trace de Tibulle (
fig. 8) pourrait favoriser une telle projection imaginaire. Il n’est pas impossible en effet d’y voir un buste coupé aux épaules et basculé tête en bas, une face quelque peu grotesque pendant à la renverse sous un vague drapé, offrant un œil, un nez, une bouche largement fendue en un rire à la Gwymplaine, un menton empâté perdu dans un cou quasi goitreux. Moins un buste de bronze ou de marbre éternisant l’auteur en gloire, toutefois, qu’un masque carnavalesque où un processus de retournement/rabaissement dégrade l’image du tendre amant de Délie. Et si, dans la forme inscrite sous le tracé Marcus Accius Plautus (
fig. 9 
), un regard quelque peu obsédé, en quête têtue de visage, peut à la rigueur déceler la trace d’une face vue de trois-quarts, c’est une face de gisant paupières closes, nez busqué, émergeant des plis d’un suaire qu’il voit se former, sans nul rapport avec le buste de marbre pour cabinet d’érudit (ou la copie de plâtre pour lycées et collèges).
Douteuse et isolée, cette image du buste se révèle inapte à organiser la série.
Dans les flexuosités de ces choses sombres, ce qui se voit surtout c’est le débris. Le débris organique. Le bout de viscère innommable, jamais identifiable. On est loin en effet de la planche d’anatomie. Même si l’œil peut saisir des fibrilles, des nervures, des sortes de minces conduits où se projettent aisément les images de capillaires sanguins, de veines, d’artères, il ne lui est jamais donné de reconnaître, là, un cœur – quoique la trace de Phèdre (
fig. 10) laisse imaginer quelque ventricule –, ailleurs, un cerveau – encore que les traces de Catulle (
fig. 11), Horace (
fig. 12 
) ou Virgile (
fig. 13) ne soient pas si étrangères à la conformation d’une cervelle –, ailleurs encore un poumon, un tronçon d’intestin, de rein. Il s’agit plutôt d’une organicité vague, de l’ordre du lambeau (
figs. 14  , 15
, 15  et 16
et 16 
). Un reste de dissection qui suppose l’« incision » préalable faite non au ciseau ou au burin mais au scalpel, et postule le geste du chirurgien ou du légiste plutôt que celui du lapicide entamant de l’outil la pierre tombale. Le blanc du papier dans ce cas tiendrait du drap plutôt que de la dalle : Titus-Carmel ne parlait-il pas à ce propos de « suaire imprégné de la seule image du
reste » [
11] ? Privé donc de l’empreinte de la Face. Celle, glorieuse, de l’écrivain éternisé dans la mandorle profane du livre. Le
reste qui la remplace n’est que déchet. Et l’imprégnation suppose moins la sueur divine, instrument du miracle de la Sainte Face, que le suintement de fluides ignobles.
Ce pourrait être osseux parfois. La trace de Lucrèce, par exemple, ne laisse pas de faire songer à des arrondis d’os – têtes de fémur ou tibia – émergeant d’un magma indécis. Concrétions, matières calcinées, comme résidus de bûchers funéraires où les offrandes fondues seraient venues s’amalgamer aux restes, non consumés, du corps. Boues volcaniques solidifiées peut-être, comme un souvenir de celles d’Herculanum. Masse terreuse agglomérée autour de débris confus.
Entre autopsie et archéologie, le dessin exhume et expose un reste qui se donne seulement pour tel, dans l’impossible rappel d’une totalité vivante. Ni celle du corps ni celle du corpus. Seulement ces bouts de tissus organiques qui sont aussi bien paquets de chiffons mal noués ; des bouts de rien, des bouts de rem, la chose, celle qui n’a de nom dans aucune langue. Les 15 Incisions latines seraient-elles alors autant de Vanités a-pathiques, neutres, voire conceptuelles ? Elles raturent les classiques emblèmes de caducité, évitent le crâne assorti ou non de quelques os longs, mais n’affirment pas moins le néant des corps et celui de la littérature en un retournement du cri triomphal d’Horace. « Non omnis moriar », s’exclamait le poète latin. Il y a peut-être quelque ironie à proposer en écho sur le blanc de la page ces bouts d’abats plus ou moins fossilisés. Si les grands noms de la poésie latine recouvrent ça, si ce qui dure, c’est ça, la poésie peut peu. Très peu.
Dans la tension entre incision lapidaire et incision chirurgicale, entre minéral et organique s’ouvre une faille de sens. Le mythe tenace de l’immortalité par l’art, de la poésie victorieuse du temps et de la mort se heurte à ces choses grises, obtuses ; paquets d’on ne sait quoi où se désigne le manque de toute certitude lénifiante. L’œuvre peut bien s’écrire, elle ne peut rien contre ça.
Si dans les 15 Incisions latines, le dessin ne se borne pas à parler de lui-même, de sa façon de marquer, masquer, maculer le support, de déposer à la surface du papier une matière sombre quand la gravure, qui incise, au sens propre, procède par enlèvement, si donc, il dit, ce dessin, quelque chose de la poésie, avec laquelle la série semble avoir affaire, ce qu’il en dit, c’est que la poésie peut très peu. Elle ne sauve pas du néant puisqu’elle n’éternise que des noms fétichisés en signes culturels. Il est douteux qu’elle reste comme le véritable monument où rayonnerait, fixée à jamais au ciel de la littérature, la gloire de l’auteur. Pas sûr en effet qu’elle échappe à la perte ; pas sûr non plus que, même lorsqu’elle a, par chance, perduré, elle conserve des lecteurs. Elle peut donc bien peu.
Mais pas rien.
Car, trace sombre sur le blanc du papier, ensemble de tracés plus ou moins énigmatiques, elle peut, comme le dessin, prendre en charge l’obscur. Non pas le dissiper, mais le désigner. Et cela, c’est mieux que rien.
Peut-être est-ce pour ce mieux que rien – aussi pauvre soit-il – qu’à partir des années quatre-vingt, Titus-Carmel va écrire – et depuis 1987 publier – des textes qui relèvent explicitement de la poésie ; estampillée telle par les sous-titres des ouvrages, reconnaissable à l’usage du vers – même si ce dernier n’est plus le mètre d’héritage. Sans illusion. En toute conscience que « ce qui fut bâti ici / n’atteindra jamais / la hauteur [des] cils » [12] de la morte, de la perdue, qu’entasser les mots ne réparera rien, ne rédimera rien. Acharné pourtant à musiquer « la musique amère de la langue / râpant l’ombre de la nuit » [13]. Parce que quelque chose vaut mieux que rien ; parce que se taire serait pire ; parce que jouer avec les mots, les faire jouer sur la page, les agencer en poèmes, les architecturer en livres permet peut-être au moins de faire consister un miroir d’encre où piéger le regard de Méduse et lui ôter ainsi – provisoirement, bien sûr, toujours provisoirement – son pouvoir de fascination.
[11] Notes d’atelier & autres textes de la contre-allée, Op. cit., p. 23.
[12] Travaux de fouille et d’oubli, Seyssel, Champ Vallon, 2000, p. 69.
[13] « Deux poèmes sans titre », Epars, Op. cit., p. 11.







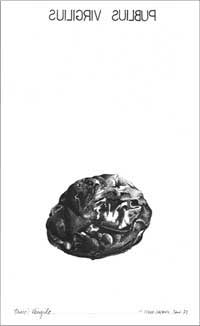
 ), un regard quelque peu obsédé, en quête têtue de visage, peut à la rigueur déceler la trace d’une face vue de trois-quarts, c’est une face de gisant paupières closes, nez busqué, émergeant des plis d’un suaire qu’il voit se former, sans nul rapport avec le buste de marbre pour cabinet d’érudit (ou la copie de plâtre pour lycées et collèges).
), un regard quelque peu obsédé, en quête têtue de visage, peut à la rigueur déceler la trace d’une face vue de trois-quarts, c’est une face de gisant paupières closes, nez busqué, émergeant des plis d’un suaire qu’il voit se former, sans nul rapport avec le buste de marbre pour cabinet d’érudit (ou la copie de plâtre pour lycées et collèges). ) ou Virgile (fig. 13) ne soient pas si étrangères à la conformation d’une cervelle –, ailleurs encore un poumon, un tronçon d’intestin, de rein. Il s’agit plutôt d’une organicité vague, de l’ordre du lambeau (figs. 14
) ou Virgile (fig. 13) ne soient pas si étrangères à la conformation d’une cervelle –, ailleurs encore un poumon, un tronçon d’intestin, de rein. Il s’agit plutôt d’une organicité vague, de l’ordre du lambeau (figs. 14  , 15
, 15  et 16
et 16  ). Un reste de dissection qui suppose l’« incision » préalable faite non au ciseau ou au burin mais au scalpel, et postule le geste du chirurgien ou du légiste plutôt que celui du lapicide entamant de l’outil la pierre tombale. Le blanc du papier dans ce cas tiendrait du drap plutôt que de la dalle : Titus-Carmel ne parlait-il pas à ce propos de « suaire imprégné de la seule image du reste » [11] ? Privé donc de l’empreinte de la Face. Celle, glorieuse, de l’écrivain éternisé dans la mandorle profane du livre. Le reste qui la remplace n’est que déchet. Et l’imprégnation suppose moins la sueur divine, instrument du miracle de la Sainte Face, que le suintement de fluides ignobles.
). Un reste de dissection qui suppose l’« incision » préalable faite non au ciseau ou au burin mais au scalpel, et postule le geste du chirurgien ou du légiste plutôt que celui du lapicide entamant de l’outil la pierre tombale. Le blanc du papier dans ce cas tiendrait du drap plutôt que de la dalle : Titus-Carmel ne parlait-il pas à ce propos de « suaire imprégné de la seule image du reste » [11] ? Privé donc de l’empreinte de la Face. Celle, glorieuse, de l’écrivain éternisé dans la mandorle profane du livre. Le reste qui la remplace n’est que déchet. Et l’imprégnation suppose moins la sueur divine, instrument du miracle de la Sainte Face, que le suintement de fluides ignobles. 

