[10] Eckhart, Livre des paraboles de la Genèse, n. 54, Op. cit., p.108 ; LW I, p. 522.
[11] Voir Eckhart, Commentaire de la Genèse, n. 116, trad. cit., p. 389 ; LW I, p. 273 : « Il faut encore noter ici ce qu’enseigne Maïmonide, livre I, chap. 2 : “L’intellect dont Dieu a doté Adam dès le principe est la perfection suprême qui était en lui avant la faute. C’est en raison de cet intellect qu’il est dit qu’Adam fut créé à l’image de Dieu […]” ».
[12] Ibid., pp. 383-385 ; LW I, p. 270.
[13] Eckhart, Sermon allemand 104a, trad. fr. E. Mangin, Le silence et le verbe. Sermons 87-105, Paris, Seuil, 2012, p. 175 ; DW IV, 1, pp. 585-586.
[14] Eckhart, Ibid., p. 176 ; DW IV, 1, pp. 589-590.
[15] Eckhart, Sermo XLIX, n. 508, Op. cit., p. 407 ; LW IV, p. 423.
[16] Eckhart, Livre des paraboles de la Genèse, n. 56, Op. cit., p. 110 ; LW I, p. 524.
[17] Ibid., n. 59, p. 111 ; LW I, p. 526.
[18] Eckhart, Commentaire de l’Evangile selon s. Jean, n. 193, pp. 349-351 ; LW III, p. 162.
[19] Eckhart, Commentaire de la Genèse, n. 115, Op. cit., p. 385 ; LW I, pp. 270-271.
[20] Voir Eckhart, Livre des paraboles de la Genèse, n. 52, Op. cit., p. 107 ; LW I, p. 522.
[21] Eckhart, Sermon allemand 17, trad.fr. J. Ancelet-Hustache, Paris, Seuil, 1974, p. 157 ; DW I, pp. 288-289.
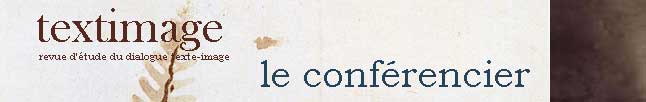
Image et image(s)
chez Maître Eckhart
- Elisabeth Boncour
_______________________________
L’intellect et sa région
L’ambition qu’Eckhart attribue à l’intellect est qu’il devienne un « monde intelligible », un monde d’images : « Le Philosophe dit aussi que « l’âme est le lieu des espèces », « non pas tout entière, mais l’intellect » [10]. L’intellect est ce qui en l’âme créée est l’image de Dieu [11]. Il est à ce titre capable de saisir au sein de la création constituée par les divers suppôts composés de matière et de forme, les quiddités séparées – les genres et les espèces – formées par l’intellect divin. En effet :
[…] il faut savoir que la créature rationnelle ou intellectuelle (rationalis sive intellectualis) diffère de toute autre créature qui lui est inférieure en ce que l’inférieur est produit à la ressemblance de ce qui est en Dieu et n’a de correspondant en Dieu que cette Idée d’après laquelle il est dit être créé. Une Idée (de ce type) est spécifiquement déterminée et est relative à la réalité créée (infra-intellectuelle) comme à une essence spécifiquement distincte (ad species distinctas). Tandis que chaque nature intellectuelle a, comme telle, plutôt pour modèle Dieu lui-même (deum similitudinem) et non pas simplement une Idée divine. La raison en est que l’intellect comme tel est “ce grâce à quoi (le sujet connaissant) devient toutes choses” et n’est pas (simplement) tel ou tel être spécifiquement déterminé. En effet, l’intellect, d’après Aristote, “est d’une certaine manière toutes choses”, et l’être en sa totalité [12].
L’intellect n’est pas créé à la ressemblance d’une idée distincte en Dieu : le modèle de l’intellect est l’intellection divine elle-même. La raison en est que l’intellect réalise, au niveau créé et fini qui est le sien, une activité semblable à celle de l’intellect divin. A la différence de l’intellect divin archétypique, l’intellect humain n’est pas cause de l’être mais est causé par lui ; toutefois, il ressemble à ce même intellect par sa capacité à accueillir les formes des êtres au point d’en devenir leur lieu, dans une sphère de pure intelligibilité. L’intellect par nature n’est rien, est néant d’être et il n’est quelque chose que parce que son activité, causée par les étants avec lesquels il entre en relation, est celle de la séparation des quiddités-formes de leur substrat matériel. Le Sermon allemand 104a en précise la manière :
Notez-le bien ! Nous avons déjà parlé à ce propos d’un intellect actif et d’un intellect passif. L’intellect abstrait les images des choses extérieures, les dépouille de la matière et de la contingence, il les introduit dans l’intellect passif et engendre en lui leur image spirituelle. Ainsi l’intellect passif est rendu fécond par l’actif, connaissant les choses et les écartant avec l’aide de l’intellect actif. Par conséquent, l’intellect passif ne peut se maintenir dans la connaissance des choses que dans la mesure où l’actif resplendit en lui [13].
Maître Eckhart distingue ainsi avec la tradition péripatéticienne l’intellect passif et réceptif de l’intellect actif ou agent : l’intellect agent abstrait les formes qui luisent et rayonnent dans la matière. Lui revient alors le rôle de la paternité des espèces – il les engendre – tandis que l’intellect passif devient le lieu de leur engendrement.
La suite du sermon continue de développer les caractéristiques de l’intellection humaine :
Notez bien, s’il en est ainsi ! L’intellect actif ne peut donner ce qu’il n’a pas, ni ne peut avoir deux images ensemble. Il a d’abord l’une et ensuite l’autre. L’air et la lumière montrent ensemble beaucoup d’images et de couleurs, cependant tu ne peux voir ni connaître que l’une après l’autre [14].
Les images produites par l’intellect actif répondent parfaitement et absolument aux titres de l’image essentielle, dégagés plus haut. L’image est l’image d’un seul, à l’exclusion de toute autre. L’intellect ne peut produire deux images ensemble et se tient dans un rapport d’univocité et d’exclusivité avec l’objet : le Sermon latin XLIX précise ainsi que « la forme la plus antérieure passe » [15].
Les images intellectuelles sont produites distinctement et selon l’ordre de l’antérieur et du postérieur, une image en chassant une autre, ce qui est la marque de la région de l’intellect. A la différence des suppôts ou étants créés, l’image formée par l’intellect est une et indivise : « La division et le nombre des suppôts sont en effet dans les suppôts, l’indivision et l’unité, en revanche, viennent de la forme et de l’espèce. Callias est en effet, autre que Socrate selon le Philosophe » [16]. L’intellect opère ainsi une réduction du multiple à l’unité de la forme-essence, saisie sous un mode intentionnel. Mais, saisissant l’homme sous l’espèce et visant une quiddité, il la distingue par là des autres : « […] l’Idée (ratio) par laquelle le lion est produit dans l’être (in esse) est autre et distincte de l’Idée du cheval » [17].
Une forme chasse une autre forme selon le progrès réalisé par l’intellect. Le rapport de l’antérieur et du postérieur est celui d’un devenir qui s’effectue selon un ordre qui va de l’individu à l’espèce et de l’espèce au genre. En effet, « […] à mesure que l’intellect est plus parfait et de rang plus élevé, ses espèces intelligibles sont plus universelles et moins nombreuses, c’est-à-dire moins fragmentées » [18]. L’intellect forme ainsi la science une et universelle propre à chaque genre jusqu’à l’objet supérieur de la métaphysique, l’être pur, l’être en tant qu’être aristotélicien. La suite du n. 115 du Commentaire de la Genèse précise :
Avicenne l’explique ainsi au livre X de sa Métaphysique : “L’accomplissement de l’âme rationnelle est de devenir un monde intelligible (saeculum intellectuale), que vienne s’inscrire en elle la forme de tout (l’être) (forma totius)”, “au point que s’y imprime de façon parfaite l’ordonnancement de tout l’être de l’univers”. […]
Il est de la raison de l’image (imaginis) de manifester pleinement la totalité du modèle dont elle est l’image, mais non pas tel élément déterminé (pris isolément) en lui. C’est pourquoi les penseurs grecs appellent l’homme microcosme, c’est-à-dire petit monde. En effet, l’intellect en tant que tel, est similitude de la totalité de l’être : il contient en lui l’universalité des êtres, mais non celui-ci ou celui-là considéré à part. Ainsi l’objet propre de l’intellect, c’est l’être pris absolument, et non pas seulement celui-ci ou celui-là [19].
La forme de l’être qui s’inscrit dans l’intellect intègre les diverses quiddités des êtres en tant que forme des formes, raison des quiddités : il est pensé par Eckhart comme la présence intellectuelle intime de Dieu en toute créature. Il faut alors comprendre l’âme comme saeculum intellectuale selon un principe de réduction des formes à une unique forme, forma ou ratio, l’être pur, cause essentielle des essences.
Le progrès de l’intellect suit donc un cheminement naturel de désimagination. Il n’y a pas deux actions successives dont la première consisterait pour l’intellect à former des images et la seconde à s’en détacher. C’est naturellement qu’il est conduit des images-quiddités à leur réduction à l’unité dans la Ratio, au-delà des phantasmes des sens, première cause originelle et essentielle des choses [20]. A ce stade, ce n’est plus l’âme qui intellige, mais Dieu qui se répand en elle dans la pureté de son être contenant toutes les formes :
Un maître dit : Il appartient à la nature et à la perfection naturelle de l’âme de devenir en soi un monde intelligible, là où Dieu a formé en elle les images de toutes choses. Celui qui dit qu’il est parvenu à sa nature doit trouver toutes choses formées en lui dans la pureté où elles sont en Dieu : non pas telles qu’elles sont en dans leur nature propre, mais telles qu’elles sont en Dieu. Ni esprit ni ange ne touche le fond de l’âme ni la nature de l’âme. Là, elle parvient au principe, au commencement où Dieu se diffuse avec bonté dans toutes les créatures [21].