
L’image dans L’Invention
de Morel de Jean
Pierre Mourey et d’Adolfo Bioy
Casares :
La « réinvention
de Mourey »
- Émilie Delafosse
_______________________________
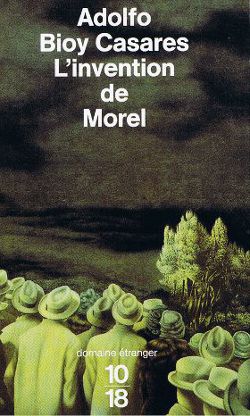
Fig. 19. A.
Bioy Casares, L’Invention
de Morel,
1992, couverture

Fig. 20. J.
P. Mourey, L'Invention
de Morel, 2007, p. 21 
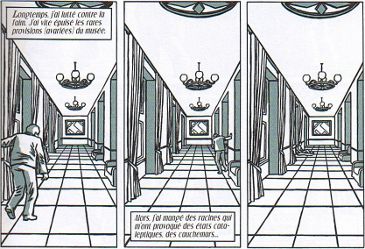
Fig. 21.
J. P. Mourey, L'Invention
de Morel, 2007, p. 21 
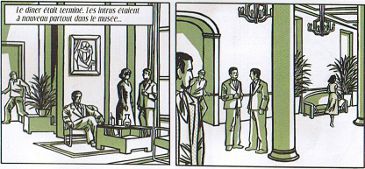
Ce
système de
répétition iconique, qui culmine dans la
figuration de la
semaine réitérée à
l’infini,
obéit à des fins narratives.
L’altération de
la temporalité, rappelons-le, constitue l’un des
motifs
classiques du fantastique, et la
« verticalité
magique du temps bouclé » [37]
est une
modalité de distorsion temporelle. Après Bioy,
qui innove
en l’associant à une tonalité
scientifique,
c’est au tour de Mourey d’exploiter cet
héritage du
fantastique « traditionnel ».
Insinué dans
un adverbe a priori anodin –
« éternellement »
(25;5) –, le
thème métaphysique du temps circulaire resurgit
lorsque
le protagoniste s’aperçoit que la conversation
entre
Faustine et Morel a déjà eu lieu :
« j’ai fini par comprendre :
leurs actes et leurs
paroles coïncidaient avec ceux d’il y a huit
jours…
L’atroce éternel retour »
(31;9). À
partir de là, les images se répètent
de plus en
plus souvent, et la bande dessinée se nourrit de ces
reprises
qui aboutissent à la semaine récurrente.
Combinées
aux motifs des costumes des personnages principaux, les variations de
la couleur d’accompagnement fournissent des
repères qui
aident le lecteur à identifier chacun des jours de la
« semaine éternelle ».
Enregistrée,
puis projetée par la machine grâce à
l’énergie marémotrice, cette semaine se
condense en
sept vignettes réparties sur deux planches. Un tel
resserrement
implique une forte fragmentation : à chaque jour
revient
une case, des ellipses articulent les éléments de
cette
série hebdomadaire. À ces sept vignettes, le
lecteur peut
revenir sans cesse, pour établir des correspondances, tisser
des
liens avec les autres cases. L’œuvre
entière, en un
sens, converge vers cette
« page-noyau » qui, en
retour, irradie le reste du livre.
La
circularité, dont
s’alimente déjà le roman de Bioy,
sous-tend
l’ensemble de la bande dessinée : le
récit
iconique perd sa linéarité pour se
répéter
à l’infini [38]. La
matérialité graphique
reflète ce procédé en même
temps
qu’elle y contribue : les techniques auxquelles
recourt
ponctuellement Mourey – la photocopie et la
réalisation
numérique des couleurs, des motifs et de certains montages
– concrétisent la thématique de la
reproductibilité, qui traverse toute
l’œuvre. Quant
aux reprises d’images, elles introduisent au cœur
du
récit une deuxième ligne narrative apparemment
dissociée des récitatifs. Parce
qu’elles sont
déjà connues, les images
répétées
semblent libres de s’écarter de ce que
décrit le
texte. Pour autant, certaines des manipulations dont elles font
l’objet à l’occasion de ces
pseudo-répétitions empêchent une
divergence totale.
À ce titre, la variation de la position du justiciable
à
l’intérieur des cases fait sens. Lafon signale
chez Bioy
la nouveauté de « chaque vision de la
"même"
scène par le fugitif, simplement parce qu’il y
ajoute
à chaque fois (…) un nouveau regard, nourri de
ses
expériences (…)
précédentes »
[39].
Dans le roman, ce processus est presque toujours
suggéré – sauf au moment où
le protagoniste
prend conscience de cet « éternel
retour »
qu’il ne comprend pas encore [40] –,
alors que la
bande
dessinée permet sa traduction à
l’image, par les
déplacements du personnage au sein des vignettes figurant
des
scènes identiques.
Chez le
lecteur, le décalage
entre récitatifs et image répétitive
produit une
sensation à rapprocher du concept freudien d’Unheimliche
– l’« inquiétante
étrangeté »,
« cette sorte de
l’effrayant qui se rattache aux choses connues depuis
longtemps,
et de tout temps familières » [41]
–, et du
phénomène de déjà-vu.
L’espèce
de paramnésie dont le lecteur fait
l’expérience en
découvrant de curieuses similitudes entre les planches 25 et
31,
par exemple, renvoie d’ailleurs à la sensation du
narrateur juste avant qu’il ne reconnaisse la conversation
déjà entendue :
« j’ai senti
qu’il se passait quelque chose
d’étrange…
mais sans arriver à savoir quoi » (31;3).
Chez
Mourey, le familier qui inquiète parce qu’il fait
retour,
ce sont les scènes que le protagoniste a
déjà
observées, les images que le lecteur a
déjà
regardées. Manifestation de
l’inquiétante
étrangeté, l’impression de
déjà-vu
née de la répétition graphique
s’avère très troublante. De fait, cette
paramnésie est propre à la lecture de la bande
dessinée : elle résulte d’un
processus de
transposition fondé sur des moyens iconiques sans
équivalent dans le roman. D’où
l’insistance
de Mourey sur le « travail de
réécriture »
particulièrement
« poussé » dans la
seconde partie de
l’ouvrage, puisqu’« il a fallu
réinventer
et développer des séquences (…)
seulement
suggérées dans le roman »
[42].
À
travers cette forme originale
d’« extension » du
texte de Bioy [43]
– il s’agit, à l’image,
d’ajouter des
épisodes déjà
narrés –, on perçoit
l’influence de L’Année
dernière à Marienbad,
où la répétition de certaines
scènes
suggère que le présent n’est que
l’infinie
reproduction du passé.
« Arrivé au terme de la
lecture de ce livre, le lecteur peut alors repartir dans
l’île inquiétante
(…) : il
possède maintenant quelques indices pour
s’orienter dans
le dédale des images et des mots » [44].
En guise de
clôture à la postface où Mourey
dévoile la
mécanique de son livre, cette invitation relaie le motif de
l’éternel retour. Si les reprises
d’images
suggèrent déjà une lecture non
linéaire,
faite d’aller-retour (à partir de la page-noyau,
notamment), la postface appelle la relecture – sans
fin ?
– de la bande dessinée.
L’essentiel
de la
transposition intermédiale se joue donc dans le
mécanisme
répétition/variation.
Décliné à
différents niveaux, il est à l’origine
de
l’inquiétante étrangeté qui
caractérise le fantastique de Mourey. Or, si dans la bande
dessinée, l’image se trouve au cœur
d’un tel
mécanisme, c’est parce qu’elle concentre
le
fantastique.
L’image, noyau du fantastique
Pour
Philippe Marion,
« le dessin n’est jamais un simple moyen
de
figuration, quelque chose en lui fait réticence,
aspérité, opacité »
[45].
Avant tout,
la graphiation est « auto-monstration (…)
d’une
identité graphique perceptible dans la
spécificité
subjective d’une empreinte » [46].
C’est sans
doute grâce à sa résistance,
à sa
« texture » que le dessin de
Mourey joue un
rôle qui va bien au-delà de sa fonction narrative
immédiate. Associés à la couleur, le
trait et le
contour présentent certains caractères propices
au
fantastique. « L’histoire a
été
entièrement dessinée au pinceau ;
certaines cases
sont également des montages à partir de
photocopies.
L’ensemble des couleurs et des motifs décoratifs,
ainsi
que quelques montages ont été
réalisés
numériquement », explique Mourey [47].
Agréable et sans fioritures, le trait se combine
à une
alternance de couleurs tendres et froides organisées en
bichromie. Si le duo vert-blanc domine – rappelant la verdeur
de
la couverture de l’édition du roman chez 10/18
(collection
« Domaine étranger »),
illustrée
par un détail d’Attente, de
l’Allemand
Richard Oelze (fig.
19)
–, il se décline aussi en
violet,
bleu et gris. Par le jeu de la bichromie (et le recours au
clair-obscur, dans le travail sur les ombres), le dessin
reflète
d’ailleurs la dualité du fantastique à
tonalité scientifique de L’Invention de
Morel [48].
En optant
pour un trait qui va
à l’essentiel, Mourey fait le choix de la
synthèse
graphique, ce qui ne l’empêche pas de soigner les
décors, naturels ou artificiels. Massive, la
présence de
décors végétaux
particulièrement plaisants
figure l’abondance de la végétation qui
caractérise l’île (fig. 20).
Les
nombreuses
représentations de l’océan (dans les
scènes
de coucher de soleil et de promenade dans les rochers) renvoient
à une insularité qui se prête
parfaitement au
fantastique – « lieu secret et
protégé
hors de l’espace et du temps, l’île est
(…) la
scène la plus propice (…) à tous les
mystères dont le déploiement nourrit le
fantastique », écrit Lafon [49].
Quant
à la
précision apportée à la
représentation de
l’intérieur du musée, elle favorise
l’évocation de l’hôtel
« immense,
luxueux, baroque » de L’Année
dernière à Marienbad. Le couloir sans
fin du dernier strip
de la planche 9, ainsi que les salons garnis de tables basses et de
plantes vertes, notamment, rappellent les décors du film
(figs.
21 et 22).
L’efficacité
narrative
du trait – au sens où le dessin
« ne renvoie
pas à un référent, mais
d’emblée
à un signifié » [50]
– et la
complexité des images ne sont pas incompatibles avec un
certain
lyrisme dans les coups de pinceau. Cette vitalité, cette
expressivité se déploie sans doute surtout
lorsque
« la pression narrative se
relâche » [51],
et que l’image cesse d’être assujettie au
récit. Le dessin de Mourey parvient alors vraiment
à incarner
les personnages, et répond ainsi à un
Robbe-Grillet qui
reprochait au roman de Bioy son excessive abstraction. En cela, la
bande dessinée rend parfaitement justice à une
œuvre qui, d’après Lafon, n’a
rien d’un
« roman
désincarné », d’une
« espèce de froid
théorème fantastique,
de montage et de démontage d’une machinerie
implacable » : « Bien au
contraire, si cette
œuvre est rapidement devenue mythique (…),
c’est
largement autant pour sa thématique amoureuse que pour sa
rigoureuse construction fantastique » [52].
[37]
J. Fabre, Le Miroir de sorcière. Essai sur la
littérature fantastique, Paris, José
Corti, « Rien de commun », 1992,
p. 227.
[38]
Ici, les répétitions narratives correspondent aux
répétitions des événements,
puisque la semaine éternelle a lieu plusieurs fois. Le
récit est donc bien
« singulatif », car ses
répétitions « ne font [que]
répondre (…) aux
répétitions de
l’histoire » (G. Genette, Figures
III, Op. cit., p. 146).
[39]
M. Lafon, « Introduction
générale », dans A. Bioy
Casares, Romans, Op. cit.,
p. IX.
[40]
« Avec lenteur dans ma conscience, mais
très ponctuellement dans la réalité,
les paroles et les mouvements de Faustine et du barbu
coïncidèrent avec leurs paroles et leurs mouvements
d’il y a huit jours » (A. Bioy Casares, L’Invention
de Morel, Op. cit., p. 47).
[41]
S. Freud, Essais de psychanalyse appliquée,
Paris, Gallimard,
« Idées », 1933, p.
165.
[42]
J. P. Mourey, « Postface », dans
J. P. Mourey et A. Bioy Casares, L’Invention de
Morel, Op. cit.
[43]
« Un premier type (…) serait
l’augmentation par addition massive, que je propose de
baptiser l’extension »
(G. Genette, Palimpsestes, Op. cit.,
p. 364).
[44]
J. P. Mourey, « Postface », dans
J. P. Mourey et A. Bioy Casares, L’Invention de
Morel, Op. cit.
[45]
P. Marion, « Scénario de bande
dessinée. La différence par le
média », Études
littéraires, vol. 26, n° 2,
1993, p. 83.
[46]
P. Marion, Traces en cases, Op. cit.,
p. 36.
[47]
J. P. Mourey, message à É. Delafosse [en ligne],
14/02/11, communication personnelle.
[48]
Julien Védrenne suggère cette correspondance
(« L’Invention de Morel »,
Le Litteraire.com).
[49]
M. Lafon, « L’île et le texte
(Pour une poétique de l’espace dans
l’œuvre d’Adolfo Bioy
Casares) », Questionnement des formes,
questionnement du sens, Montpellier, CERS, 1997, t. II, p.
948.
[50]
Th. Groensteen, Système de la bande
dessinée, Op. cit., p. 192.
[51]
Ibid.
[52]
M. Lafon, « Introduction »
à L’Invention de Morel, dans
A. Bioy Casares, Romans, Op. cit.,
p. 5.


