
Dérive, secousse, brasillement.
La dynamique intermédiale dans Drancy
la muette de Yannick Haenel et Claire Angelini
- Corentin Lahouste
_______________________________

Fig. 7. C. Angelini et Y. Haenel,
Drancy la muette, 2013 

Fig. 8. C. Angelini et Y. Haenel,
Drancy la muette, 2013 
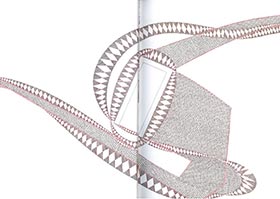
Fig. 9. C. Angelini et Y. Haenel,
Drancy la muette, 2013 
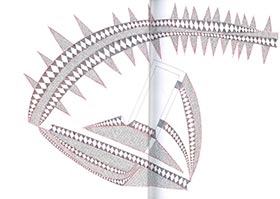
L’intervalle que la troisième image ouvre et qu’elle représente peut dès lors être vu comme un moment épiphanique : au-delà du mouvement de battement qu’elle opère, elle se présente comme le lieu d’une révélation. Dans une optique similaire, elle peut par conséquent être appréhendée à partir du concept de contretemps, suivant le sens qu’a pu donner Eric Méchoulan à ce terme qu’il rapproche au demeurant du processus intermédial : « [là] où se contractent les idées et où les événements se dilatent » [20]. Elle se présente alors comme moment d’arrêt, comme un espace vide en quelque sorte, pas de l’ordre de la vacuité (du néant), mais qui est plutôt à comprendre en tant que « point de condensation », « point de densité », car le vide chez Haenel représente en réalité l’espace du possible, du renouveau – il est un réservoir de potentialités, une « chance » [21]. C’est ainsi que l’entre-deux s’érige comme l’endroit privilégié à partir duquel peut advenir du neuf, de l’inédit. De plus, par ces deux termes – intervalle et contretemps – resurgit la question du silence, étant donné qu’en musique tous deux possèdent un lien au silence : l’intervalle en est un, tandis que le contretemps joue avec lui. Du silence, du vide, nait la possibilité d’un autre discours.
Lucioles
Plus qu’à voir autrement, c’est à l’envers du visible, à ses soubassements, qu’ouvre Drancy la muette, afin d’y percevoir les spectres du passé, ou, en se référant à la pensée de Georges Didi-Huberman, les lucioles qui s’y dissimulent. En effet, Haenel, à l’instar d’Angelini, dit chercher « des traces, des signes de survivance » (p. 26, nous soulignons) au cœur d’une mémoire « figée dans la boue de l’hiver, diluée dans la grisaille urbaine, maçonnée dans la brique et le mortier d’un immeuble fermé sur lui-même comme une large tenaille » (p. 21) car il pressent que « quelque chose (…) [de Drancy] s’adresse au monde dans lequel nous vivons, à ses dispositifs de contrôle, à son délire d’exclusion » (pp. 26-27, nous soulignons). La couverture de l’ouvrage (l’objet dans sa matérialité) appuie cette intuition car, au-delà du fer à cheval doré qui l’orne et qui peut symboliser Drancy (« La caserne de Drancy formait un fer un cheval » [p. 22]), elle est surtout constituée d’un fond noir empailletté qui peut faire écho aux éclats lumineux du coléoptère dans la nuit (fig. 7). Il s’agit donc de révéler une présence (p. 41), imperceptible, mais pourtant déterminante. C’est alors la banalité du lieu, son inconsistance qui permet aux lucioles d’apparaitre car c’est précisément dans le noir, en dehors des projecteurs, « de l’espace surexposé, féroce, trop lumineux de notre histoire présente » [22] qu’elles peuvent poindre :
[…] dissous dans le paysage de la cité, flottant dans l’invisibilité de la hantise, le camp existe peut-être mieux. Sa mémoire s’accomplit en s’ouvrant au brouillard qui l’estompe. Ce brouillard le protège du folklore indécent des musées, de la commémoration, de ce tourisme d’itinéraires fléchés, d’audioguides et de tours-opérateurs dont même les camps d’extermination sont devenus l’objet, réduits à n’être plus que des lieux culturels, c’est-à-dire à être consommés distraitement (p. 34).
Chez Haenel, les lucioles du lieu se matérialisent sous la forme de phrases qui émergent dans sa tête. La première jaillit lors de sa première rencontre avec la cité de la Muette : « La France est un pays glacé où l’on erre en fermant les yeux sur le pire » (p. 21). Cette phrase est prescience et lancement de sa réflexion : elle rend d’ailleurs compte de l’essence du propos développé dans le premier fragment du texte. La seconde est une phrase d’Agamben qui apparait plus loin dans le récit alors qu’il y pensait depuis son arrivée sur place : « Le camp est la matrice secrète de la politique dans laquelle nous vivons toujours, que nous devons apprendre à reconnaitre à travers toutes ses métamorphoses, dans les zones d’attente de nos aéroports comme dans les banlieues de nos villes » (p. 33). La dernière, « pauvres mots » qui l’affligent, provient de L’Espèce humaine [23] de Robert Antelme : « un monde dressé furieusement contre les vivants » (p. 37). Ces trois formules/sentences, « phrases-talismans » [24], aiguillons ardents, résument l’ensemble du propos tenu par Haenel dans son texte, elles en constituent non seulement le squelette mais surtout la force motrice. Chez Angelini, une luciole pourrait être, par exemple, l’irruption d’une affiche publicitaire pour l’insecticide KAPO placardée sur un mur de la cité. Et comme le note Haenel, « [l]e mot KAPO, apparaissant sur le mur d’une cité qui fut un camp, prend valeur d’ironie terrible » (p. 32) (fig. 8).
Ces lucioles, diverses, à saisir, qui sont autant de signes dans la nuit, de résistances aux ténèbres, rendent au lieu « la sémiotisation qui lui fait défaut dans le réel » [25], suivant un des éléments développés par Myriam Watthee-Delmotte dans son commentaire de l’ouvrage. Elles constituent ce qui permet aux deux artistes, errants [26], de trouver leur chemin [27] dans l’obscurité de Drancy. Bien plus, participant du mouvement épiphanique, la luciole peut représenter la « troisième image » [28]. Elle agit comme une concrétisation de ce syntagme, de même qu’elle se manifeste comme la figure sous-jacente développée et portée par le livre. Par ailleurs, plus que composée de lucioles, l’œuvre elle-même se présente comme une luciole, comme un « point de feu » (p. 37), comme une « troisième image », en tant qu’« expérience fragile et tumultueuse » (p. 26), que discours erratique et singulier sur la Shoah, son héritage et notre présent.
Drancy la muette propose ainsi une reconfiguration de l’appréhension de notre époque à l’aune des éclats – qui sont autant de révélateurs – de ce lieu maudit que constitue Drancy. A l’instar d’Agamben (du travail d’archéologie philosophique qu’il réalise), cité au demeurant par Haenel, cet ouvrage, pour reprendre les termes de Didi-Huberman, « envisage le contemporain dans l’épaisseur considérable et complexe de ses temporalités enchevêtrées » [29]. En d’autres mots, Haenel et Angelini font se confronter, se percuter l’Autrefois avec le Maintenant et cette rencontre, comme a pu le formuler Didi-Huberman, produit « une lueur, un éclat, une constellation où se libère quelque forme pour notre Avenir lui-même » [30]. Leur œuvre peut être vue, en fin de compte, à travers la circulation entre les formes et les époques qu’elle propose, comme une danse, semblable à celle des lucioles dans la nuit ; ce que peut notamment laisser penser le mouvement et les entrelacements des dessins qui ouvrent le livre (figs. 9 et 10). Drancy la muette est, en ce sens, secousse, tremblement, brasillement. En somme, dévoilant l’invisible, traduisant l’informulable, déjouant l’oubli et rejouant le partage du sensible [31], il permet avant tout de mettre en œuvre, par la dynamique intermédiale qui le traverse, un rapport renouvelé au réel et à la mémoire et d’engager le lecteur vers « cet "à côté" toujours en réserve du possible » [32].
[20] E. Méchoulan, « Bergson anachronique, ou la métaphysique est-elle soluble dans l’intermédialité ? », dans Intermédialités, n°3 – « Devenir Bergson », printemps 2004, p. 132.
[21] Voir Y. Haenel, Les Renards pâles, Paris, Gallimard, « Folio », 2013, p. 46.
[22] G. Didi-Huberman, Survivance des lucioles, Paris, Minuit, 2009, p. 59.
[23] Roman qui relate l’expérience de l’auteur déporté aux camps de Buchenwald puis Dachau.
[24] M. Watthee-Delmotte, « Comment saisir l’infini ? Les ekphrasis de Yannick Haenel », dans B. Curatolo & B. Denker-Bercoff (dir.), Du Tout. Tout, totalité, totalisation dans la littérature, Dijon, Editions universitaires de Dijon, 2015, p. 214.
[25] Ibid., p. 213.
[26] Fait écho au titre donné par Claire Angelini à son travail : Une errance photographique, cité de la Muette.
[27] Fait écho à la phrase de Haenel : « j’essayais de trouver mon chemin » (p. 27).
[28] La « troisième image » peut ainsi être vue comme « image-luciole ».
[29] G. Didi-Huberman, op. cit., p. 59.
[30] Ibid., p. 51.
[31] Voir J. Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.
[32] D. Klébaner, op. cit., p. 46.


